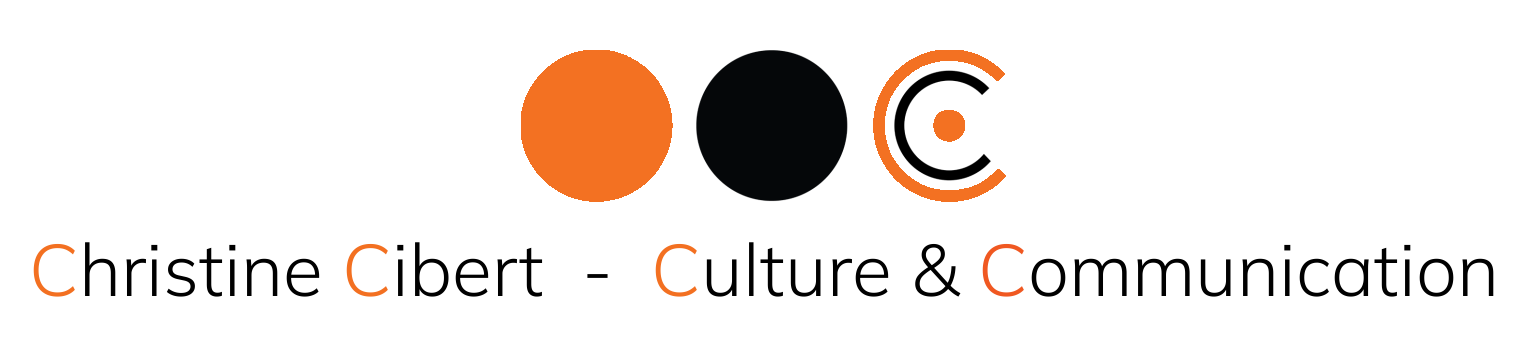Amilton Neves
Madrinhas de guerra
Fortaleza, MFF (Maputo Fast Forward)
Maputo, Mozambique
12 août – 30 novembre 2018 (prolongée jusqu’au 28 février 2019)
Commissaire d’exposition invitée par Alda Costa et Moises Timba

BIOGRAPHIE
Amilton Neves est un photographe professionnel basé au Mozambique dont le travail examine les problèmes sociaux contemporains à l’aide de techniques narratives et documentaires. Ses projets se concentrent sur l’approche des perceptions des individus en marge de la société à travers des récits d’autonomisation, tout en s’intéressant aux aspects souvent négligés de notre histoire moderne.
Amilton Neves a participé à des cours de formation à la Sooke School of Photography au Canada et au Nuku Studio au Ghana, et a exposé à plusieurs reprises au Centre culturel franco-mozambicain. Son travail a également été présenté au Ghana, au Portugal, au Brésil, en Éthiopie et au Canada. En plus de ses propres projets, Amilton Neves travaille également en tant que photographe documentaire indépendante à travers l’Afrique.
À PROPOS DE Madrinhas de guerra
Grâce aux yeux du photographe Amilton Neves, nous sommes guidés dans un voyage très personnel et intime. Situés entre des murs en ruine, en tôle ondulée ou en bois peint, en passant par quelques petites portes modestes, nous entrons dans les maisons délabrées de plusieurs vieilles femmes mozambicaines. Dans cet espace privé, nous avons accès à leur vie, nous allons à leur rencontre, à la reconnaissance de leur passé et à l’écoute d’un épisode caché de l’histoire du Mozambique.
BIOGRAPHIE
Amilton Neves est un photographe professionnel basé au Mozambique dont le travail examine les problèmes sociaux contemporains à l’aide de techniques narratives et documentaires. Ses projets se concentrent sur l’approche des perceptions des individus en marge de la société à travers des récits d’autonomisation, tout en s’intéressant aux aspects souvent négligés de notre histoire moderne.
Amilton Neves a participé à des cours de formation à la Sooke School of Photography au Canada et au Nuku Studio au Ghana, et a exposé à plusieurs reprises au Centre culturel franco-mozambicain. Son travail a également été présenté au Ghana, au Portugal, au Brésil, en Éthiopie et au Canada. En plus de ses propres projets, Amilton Neves travaille également en tant que photographe documentaire indépendante à travers l’Afrique.
À PROPOS DE Madrinhas de guerra
Grâce aux yeux du photographe Amilton Neves, nous sommes guidés dans un voyage très personnel et intime. Situés entre des murs en ruine, en tôle ondulée ou en bois peint, en passant par quelques petites portes modestes, nous entrons dans les maisons délabrées de plusieurs vieilles femmes mozambicaines. Dans cet espace privé, nous avons accès à leur vie, nous allons à leur rencontre, à la reconnaissance de leur passé et à l’écoute d’un épisode caché de l’histoire du Mozambique.
EN TÊTE À TÊTE AVEC AMILTON NEVES
Christine Cibert (CC) – En tant que jeune photographe mozambicaine, comment avez-vous commencé cette nouvelle série de photographies sur Godmothers of War
Amilton Neves (AN) – J’ai eu l’idée de travailler sur ce sujet à cause d’un discours célèbre de Samora Machel dans lequel il a déclaré : “Les marraines de la guerre sont des explosifs à long terme, nous devons arrêter ce système dans notre société.” Mères ou tantes, elles ne veulent pas en parler. Elles vous disent brièvement ce qui s’est passé mais ne souhaitent pas partager les détails. C’est pourquoi j’ai délibérément voulu documenter cette histoire souvent oubliée, afin qu’elle ne soit pas seulement rappelée par la génération plus âgée, “assimilée” ou par les gens de l’armée. C’est une histoire qui devrait être connue de tous et pourtant la plupart des gens ne le savent pas.
CC – Pouvez-vous nous en dire plus sur le contexte historique ?
AN – “Godmothers of War” est un projet racontant l’histoire des femmes mozambicaines qui ont participé au Mouvement National des Femmes de 1961 à 1974. Ces femmes faisaient partie de la stratégie du gouvernement portugais qui devait apporter un soutien moral aux soldats des colonies, se battant sur les lignes de front pendant la lutte pour l’indépendance. Par le biais de campagnes de lettres adressées à des soldats – dont beaucoup ne se sont jamais rencontrés -, les marraines de guerre ont joué un rôle crucial dans le soutien psychologique des forces armées coloniales. Certaines Madrinhas sont allées jusqu’à rencontrer et rendre visite régulièrement aux soldats auxquels elles ont écrit, développant des relations profondes, conduisant parfois à des promesses de mariage lorsque les jeunes hommes sont revenus à la fin de la guerre. En échange de leur soutien aux soldats pendant la guerre, certaines de ces femmes ont réussi à obtenir des avantages économiques et sociaux. Mais en 1974, à la fin de la guerre d’indépendance, le Mouvement National des Femmes s’est officiellement terminé avec elle. Après cela, les épouses de guerre ont été ostracisées au sein de la société mozambicaine pour leur rôle de soutien des forces coloniales.
CC – Était-il difficile d’entrer en contact avec elles ?
AN – J’ai commencé à faire des recherches sur le sujet afin de trouver des photographies d’archives et des récits. Finalement, j’ai réussi à parler à un ancien soldat de l’armée qui avait eu une marraine de guerre qui était encore vivante et basée à Mafalala chez qui il m’a emmenée. Bien qu’elle soit maintenant décédée, il m’a fallu trois mois pour la convaincre de me laisser prendre son portrait. A partir de ce moment-là, grâce à ce défi relevé, j’étais vraiment été intéressé par ce projet. Elle a ensuite accepté de me présenter aux d’autres marraines et durant trois ans, je me suis rendu au domicile d’une cinquantaine de marraines de la guerre qui vivent encore à Maputo mais qui ont une vie très différente à l’époque coloniale et après l’indépendance où elles sont été marginalisées.
CC – La série est présentée pour la première fois Mozambique. L’avez-vous montré ailleurs auparavant ?
AN – Le travail a été exposé sur SDN (cours en ligne) lorsque j’ai été nommé photographe du mois (janvier 2018). Il a également été exposé dans le cadre du volet Nuku Studio du Festival de la photo d’Addis (2016) et tout récemment au Festival de la photographie de Nuku au Ghana lancé en septembre dernier. Il a été examiné à PhotoNOLA (Nouvelle-Orléans) en 2017. La série a également remporté le Portfolio Review Prize au Palm Springs Photo Festival (2018) et a été sélectionnée pour le 2018 Contemporary African Photography Award.
FUTUR PASSÉ
Nous avons tendance à regarder le passé comme quelque chose d’inerte. En tant que quelque chose qui est définitivement et irréparablement derrière nous, encapsulé et fixé pour toujours dans notre mémoire et impossible d’agir ou de changer. En ce sens, le passé semble être incontestablement opposé à notre perception du présent, qui selon nous est en perpétuelle mutation.
Mais en réalité, cette perception est trompeuse. En fait, chaque fois que nous plongeons dans nos mémoires ou que nous pensons au passé, nous le mettons en mouvement. La science contemporaine nous dit que juste en convoquant ou en verbalisant des souvenirs du passé, nous les modifions, les reconfigurions et les réécrivions. Nous recadrons constamment les événements et les faits qui, à notre avis, étaient codés pour toujours dans nos cellules cérébrales. Et ainsi, notre souvenir du passé est influencé sans équivoque par nos expériences, sentiments et émotions présents. The Past n’est certainement pas un élément fixe, mais un paysage fluide.
De plus, la science contemporaine conteste depuis quelques décennies notre perception conventionnelle du temps. Au niveau quantique, il semble que le temps s’écoule, chaotiquement et simultanément, dans toutes les directions, ce qui, aussi impensable soit-il, implique qu’il existe des rétroactions permanentes entre le passé et le futur et le futur et le passé. Ainsi, disent certains, notre perception conventionnelle du temps, le unidirectionnel, est une illusion. En fait, le temps, en soi, est l’illusion ultime.
L’avenir de l’avenir / Réinventer les récits d’Afrique devrait être encadré dans cette approche conceptuelle plus large. Comme quelqu’un l’a sagement décrit, le passé doit être considéré comme un « compagnon de voyage », toujours présent, toujours avec nous. Et il en va de même pour l’avenir. L’avenir n’est pas dans l’avenir, il est ici aujourd’hui. Ainsi, cette exposition nous invite à nous engager dans cette « conversation », à habiter cet espace intemporel et à découvrir, à travers ce dialogue constant, comment nous pouvons aborder et affecter notre présent.
Rui Trindade • MFF, Directeur de la programmation
EN TÊTE À TÊTE AVEC AMILTON NEVES
Christine Cibert (CC) – En tant que jeune photographe mozambicaine, comment avez-vous commencé cette nouvelle série de photographies sur Godmothers of War
Amilton Neves (AN) – J’ai eu l’idée de travailler sur ce sujet à cause d’un discours célèbre de Samora Machel dans lequel il a déclaré : “Les marraines de la guerre sont des explosifs à long terme, nous devons arrêter ce système dans notre société.” Mères ou tantes, elles ne veulent pas en parler. Elles vous disent brièvement ce qui s’est passé mais ne souhaitent pas partager les détails. C’est pourquoi j’ai délibérément voulu documenter cette histoire souvent oubliée, afin qu’elle ne soit pas seulement rappelée par la génération plus âgée, “assimilée” ou par les gens de l’armée. C’est une histoire qui devrait être connue de tous et pourtant la plupart des gens ne le savent pas.
CC – Pouvez-vous nous en dire plus sur le contexte historique ?
AN – “Godmothers of War” est un projet racontant l’histoire des femmes mozambicaines qui ont participé au Mouvement National des Femmes de 1961 à 1974. Ces femmes faisaient partie de la stratégie du gouvernement portugais qui devait apporter un soutien moral aux soldats des colonies, se battant sur les lignes de front pendant la lutte pour l’indépendance. Par le biais de campagnes de lettres adressées à des soldats – dont beaucoup ne se sont jamais rencontrés -, les marraines de guerre ont joué un rôle crucial dans le soutien psychologique des forces armées coloniales. Certaines Madrinhas sont allées jusqu’à rencontrer et rendre visite régulièrement aux soldats auxquels elles ont écrit, développant des relations profondes, conduisant parfois à des promesses de mariage lorsque les jeunes hommes sont revenus à la fin de la guerre. En échange de leur soutien aux soldats pendant la guerre, certaines de ces femmes ont réussi à obtenir des avantages économiques et sociaux. Mais en 1974, à la fin de la guerre d’indépendance, le Mouvement National des Femmes s’est officiellement terminé avec elle. Après cela, les épouses de guerre ont été ostracisées au sein de la société mozambicaine pour leur rôle de soutien des forces coloniales.
CC – Était-il difficile d’entrer en contact avec elles ?
AN – J’ai commencé à faire des recherches sur le sujet afin de trouver des photographies d’archives et des récits. Finalement, j’ai réussi à parler à un ancien soldat de l’armée qui avait eu une marraine de guerre qui était encore vivante et basée à Mafalala chez qui il m’a emmenée. Bien qu’elle soit maintenant décédée, il m’a fallu trois mois pour la convaincre de me laisser prendre son portrait. A partir de ce moment-là, grâce à ce défi relevé, j’étais vraiment été intéressé par ce projet. Elle a ensuite accepté de me présenter aux d’autres marraines et durant trois ans, je me suis rendu au domicile d’une cinquantaine de marraines de la guerre qui vivent encore à Maputo mais qui ont une vie très différente à l’époque coloniale et après l’indépendance où elles sont été marginalisées.
CC – La série est présentée pour la première fois Mozambique. L’avez-vous montré ailleurs auparavant ?
AN – Le travail a été exposé sur SDN (cours en ligne) lorsque j’ai été nommé photographe du mois (janvier 2018). Il a également été exposé dans le cadre du volet Nuku Studio du Festival de la photo d’Addis (2016) et tout récemment au Festival de la photographie de Nuku au Ghana lancé en septembre dernier. Il a été examiné à PhotoNOLA (Nouvelle-Orléans) en 2017. La série a également remporté le Portfolio Review Prize au Palm Springs Photo Festival (2018) et a été sélectionnée pour le 2018 Contemporary African Photography Award.
FUTUR PASSÉ
Nous avons tendance à regarder le passé comme quelque chose d’inerte. En tant que quelque chose qui est définitivement et irréparablement derrière nous, encapsulé et fixé pour toujours dans notre mémoire et impossible d’agir ou de changer. En ce sens, le passé semble être incontestablement opposé à notre perception du présent, qui selon nous est en perpétuelle mutation.
Mais en réalité, cette perception est trompeuse. En fait, chaque fois que nous plongeons dans nos mémoires ou que nous pensons au passé, nous le mettons en mouvement. La science contemporaine nous dit que juste en convoquant ou en verbalisant des souvenirs du passé, nous les modifions, les reconfigurions et les réécrivions. Nous recadrons constamment les événements et les faits qui, à notre avis, étaient codés pour toujours dans nos cellules cérébrales. Et ainsi, notre souvenir du passé est influencé sans équivoque par nos expériences, sentiments et émotions présents. The Past n’est certainement pas un élément fixe, mais un paysage fluide.
De plus, la science contemporaine conteste depuis quelques décennies notre perception conventionnelle du temps. Au niveau quantique, il semble que le temps s’écoule, chaotiquement et simultanément, dans toutes les directions, ce qui, aussi impensable soit-il, implique qu’il existe des rétroactions permanentes entre le passé et le futur et le futur et le passé. Ainsi, disent certains, notre perception conventionnelle du temps, le unidirectionnel, est une illusion. En fait, le temps, en soi, est l’illusion ultime.
L’avenir de l’avenir / Réinventer les récits d’Afrique devrait être encadré dans cette approche conceptuelle plus large. Comme quelqu’un l’a sagement décrit, le passé doit être considéré comme un « compagnon de voyage », toujours présent, toujours avec nous. Et il en va de même pour l’avenir. L’avenir n’est pas dans l’avenir, il est ici aujourd’hui. Ainsi, cette exposition nous invite à nous engager dans cette « conversation », à habiter cet espace intemporel et à découvrir, à travers ce dialogue constant, comment nous pouvons aborder et affecter notre présent.
Rui Trindade • MFF, Directeur de la programmation
Madrinhas de guerra
Jamestown Café, Nuku Photo Festival
Accra, Ghana
18 septembre – 24 août 2018
Commissaire d’exposition
© Amilton Neves • tous droits réservés • mentions légales •
© Christine Cibert • tous droits réservés • mentions légales •